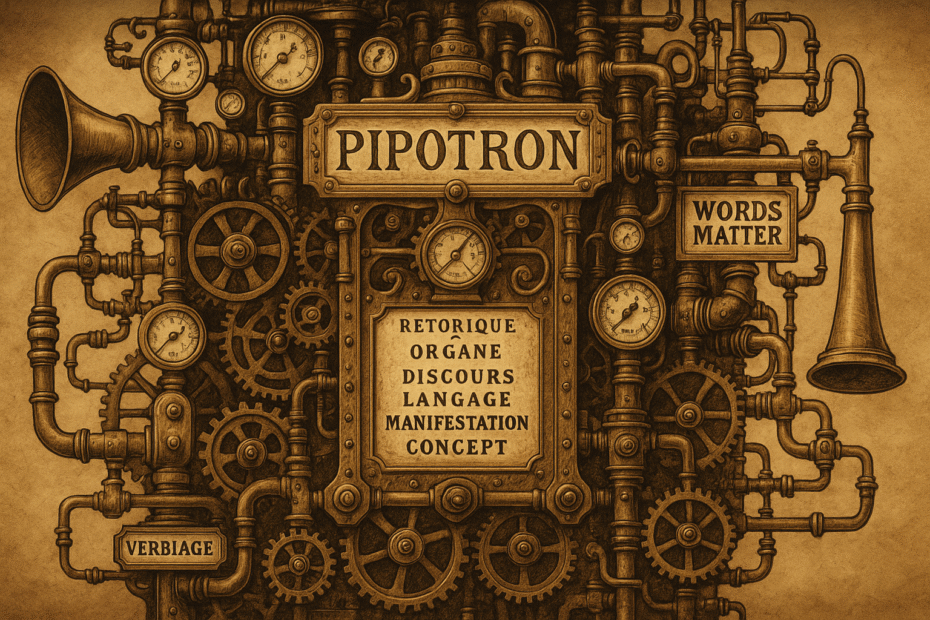….retorique dans l’image, trop bien, CQFD.
Accessibilité: Résumé audio
Introduction
L’irruption des modèles de langage de grande taille (Large Language Models – LLM) dans le monde éducatif suscite à la fois espoirs et inquiétudes. Des plateformes conversationnelles grand public comme ChatGPT ont démontré dès 2023 une capacité hors-norme à générer du texte cohérent et bien rédigé, donnant l’illusion d’une omniscience. Cependant, derrière le vernis d’une prose impeccable, les dérives d’un usage non maîtrisé de ces modèles propriétaires sont rapidement apparues. Hallucinations, informations inventées et références fabriquées de toutes pièces entachent régulièrement leurs réponses[1][2]. De fait, sans encadrement ni filtrage, les réponses brutes d’un LLM ne valent rien en termes de fiabilité. Utiliser ces outils tels quels en contexte éducatif reviendrait à interroger un pipotron algorithmique – un perroquet statistique débitant un texte à l’aspect sérieux mais dénué de garantie de vérité[3][4].
Face à cette situation, il est impératif d’analyser pourquoi ces modèles se comportent ainsi et comment on peut en canaliser l’usage de manière constructive. Le présent article propose :
(1) de dénoncer les écueils d’un usage naïf des LLM en éducation, en illustrant les dangers des hallucinations incontrôlées ;
(2) d’expliquer l’origine probabiliste de ces dérives, inhérente au fonctionnement même des modèles et insusceptible d’être corrigée sans apport technique ;
(3) de proposer un cadre technique progressif pour intégrer les LLM en classe, depuis le prompt le plus simple jusqu’au scénario avancé combinant données documentaires et techniques de pilotage sophistiquées ;
(4) de décrire les méthodes avancées (chaîne de pensée, arbre de décision, auto-interrogation, etc.) qui permettent d’améliorer la fiabilité du raisonnement de l’IA ;
enfin (5) d’insister sur la nécessité de former les enseignants à ces nouveaux outils, en dépassant le discours incantatoire sur « l’esprit critique » trop souvent brandi sans maîtrise des conditions techniques sous-jacentes. L’ensemble de la discussion adoptera un ton rigoureux et nuancé, propre au domaine académique, non sans quelques touches d’ironie à l’égard des visions les plus naïves ou technocratiques de l’IA éducative.
1. Réponses non maîtrisées : des hallucinations massives aux « pipotron » scolaires
Les LLM actuellement disponibles, en particulier les modèles fermés propriétaires, sont connus pour générer fréquemment des informations inexactes ou totalement inventées, phénomène qualifié d’hallucination. En contexte éducatif, ces errements peuvent avoir des conséquences graves : propagation de fausses connaissances, renforcement de misconceptions, tromperie des élèves et des enseignants sur la fiabilité des savoirs transmis[5]. Plusieurs études récentes ont quantifié l’ampleur du problème. Par exemple, sur 50 propositions de recherche rédigées par ChatGPT, on a trouvé que 28 des 178 références bibliographiques citées n’existaient pas dans la réalité[1]. De même, dans un échantillon d’articles médicaux générés automatiquement, près de 46 % des références étaient fictives (seulement 7 % étant pleinement correctes)[1]. Ces chiffres alarmants illustrent qu’un LLM utilisé sans précaution peut affirmer n’importe quoi avec aplomb, y compris en fournissant de fausses sources pour accréditer ses dires. Un exemple frappant rapporté par la presse tech : un chatbot a un jour affirmé que Leonardo da Vinci avait peint la Joconde en 1815, soit trois siècles après la date réelle[2]. Ce genre de réponse aberrante, énoncée sur le ton le plus naturel, souligne à quel point un LLM non bridé « ment avec confiance ».
En milieu scolaire, accepter sans vérification les sorties d’un tel modèle revient à introduire un brouillage informationnel constant. Certes, le texte produit paraît souvent convaincant : la grammaire est correcte, le style fluent, aucune hésitation dans le propos. Mais comme le résume B. Bayart, « ça produit un texte grammaticalement plutôt correct… [mais] ça n’a pas forcément de sens »[3]. Autrement dit, cohérence formelle ne rime pas avec justesse factuelle. Bayart illustre le problème par une anecdote devenue célèbre : avoir demandé à ChatGPT la liste des 100 nombres premiers pairs supérieurs à 2. Le modèle, ne « sachant » pas qu’il n’existe par définition qu’un seul nombre premier pair (le 2), a fourni une liste d’entiers sans queue ni tête, dont le 2 deux fois, 57 (qui n’est ni pair ni premier) et d’autres absurdités, le tout dans un français impeccable[6][7]. Confronté à l’erreur, le système s’est excusé et a aussitôt proposé une autre liste tout aussi erronée[8]. Ce cas caricatural cache une réalité plus inquiétante : dès qu’une question sort un peu du cadre ou comporte un piège conceptuel, le LLM aura tendance à répondre quelque chose de « plausible » en surface mais de complètement faux en profondeur.
Dans un contexte ludique ou pour un utilisateur expert, ces dérapages peuvent prêter à rire ou être détectés à temps. En revanche, pour un élève ou un enseignant non spécialiste du sujet, le risque de se laisser duper est réel[9][4]. Un élève de lycée demandant des explications sur le boson de Higgs pourrait recevoir un exposé rempli de termes savants et de phrases bien construites, mais truffé d’âneries subtiles impossibles à repérer sans connaissances préalables. L’illusion de fiabilité est d’autant plus dangereuse que « si tu ne pines rien au domaine […] [le LLM] va te faire un texte qui a l’air de tenir la route, avec les bons buzzwords, […] tout ce qu’il a remonté comme gloubi-boulga »[4]. En somme, l’usage brut d’un LLM en classe, sans méthode ni regard critique, équivaut à introduire un générateur de discours creux dans la pédagogie. C’est cette aberration qu’il convient d’écarter d’emblée : les modèles de langage ne sauraient être employés comme oracles infaillibles ou assistants magiques dans l’éducation, tant qu’on n’a pas mis en place des garde-fous techniques et méthodologiques.
2. Origines des hallucinations : un comportement probabiliste, pas une connaissance fiable
Pourquoi les LLM « hallucinent-ils » de la sorte ? La réponse tient à leur mode de fonctionnement intrinsèque, fondé sur la probabilité et non sur la vérité. Un modèle de langage n’a ni compréhension profonde du monde ni capacité de vérification factuelle : il se contente de prédire la séquence de mots la plus probable qui suit une question, d’après les milliards de phrases dont il a été nourri[10]. Autrement dit, il imite la forme statistiquement la plus fréquente d’une réponse plausible, plutôt que de raisonner sur le fond. Si une tournure apparaît souvent dans les textes de son corpus, il l’utilisera, même si cela conduit à une contre-vérité dans le cas présent. Aucun « sens du réel » n’est intégré par défaut dans ces modèles, qui ne font qu’enchaîner des tokens selon des patterns appris.
Ce comportement probabiliste explique en grande partie les dérives constatées. Le LLM n’a pas de modèle interne du vrai et du faux : il ne sait pas que 57 n’est pas un nombre premier, ni que la Joconde ne date pas du XIXème siècle. Il va produire une réponse ayant l’apparence d’une information fiable (par exemple en citant une source imaginaire), simplement parce que cela correspond à ce qu’on attendrait d’un texte informatif, même s’il doit l’inventer. Comme le note une analyse, le modèle génère ainsi des réponses « d’un ton assuré, plausibles en apparence mais factuellement incorrectes » du fait même qu’il n’a pas de réelles capacités de raisonnement ou de compréhension[10]. En somme, l’hallucination n’est pas un bug aléatoire mais une conséquence structurelle : tant qu’on ne fournit pas de garde-fou, l’IA remplira les vides de sa connaissance par des extrapolations hasardeuses.
Peut-on espérer remédier à ces travers sans intervention extérieure ? Les fine-tuning et autres réglages apportés par les concepteurs (comme l’instruction de « ne pas inventer de sources ») atteignent vite leurs limites. Malgré les progrès de l’alignement, « les raisons de ces hallucinations […] tiennent aux biais des données d’entraînement, aux limites du modèle linguistique et à un manque de compréhension contextuelle »[11], facteurs difficilement gérables sans changer l’architecture ou injecter de l’information supplémentaire. Autrement dit, aucune consigne magique dans le prompt ne fera disparaître le problème. Demander « sois factuel et fiable » à un LLM revient à dire « ne fais pas d’erreur » à un élève : l’intention est louable, mais le mécanisme pour y parvenir n’est pas fourni. Pour corriger le tir, il faut apporter au modèle ce qu’il ne possède pas par défaut: une forme de vérification ou de connaissances contrôlées via des interventions techniques explicites que nous détaillerons plus loin. En l’état, ignorer cette réalité et utiliser un LLM fermé de manière naïve conduit inévitablement à des dérapages.
3. Vers un cadre d’usage structuré des LLM en éducation
Plutôt que de bannir purement et simplement les IA génératives de la salle de classe, il convient de faire évoluer les usages en les structurant. Entre la question ouverte posée à ChatGPT comme on interroge Google, et le déploiement sophistiqué d’un assistant pédagogique piloté finement, il existe plusieurs niveaux de maîtrise. Nous proposons ci-dessous un cadre progressif en trois paliers, du plus simple au plus élaboré, pour intégrer les LLM dans l’éducation de manière responsable. Chaque niveau de prompt est illustré par un exemple concret, afin de montrer comment on peut graduellement reprendre le contrôle sur la génération du modèle et améliorer la qualité de ses réponses.
- Niveau 1 : Prompt naïf de type « moteur de recherche »
C’est l’utilisation la plus basique, où l’on interroge le LLM avec une question ouverte, sans fournir de contexte particulier ni cadre de réponse. Par exemple : « Explique-moi les causes de la Révolution française ». Le modèle, livré à lui-même, va puiser dans sa mémoire statistique et produire une réponse discursive. Aucun ancrage documentaire n’est ici donné : on s’en remet entièrement à ce que l’IA croit savoir du sujet. Ce niveau correspond peu ou prou à l’expérience utilisateur standard sur ChatGPT. Or, comme on l’a vu, une telle réponse brute a toutes les chances de comporter erreurs ou approximations, voire des âneries très sérieuses dites avec assurance. En contexte éducatif, ce niveau d’usage devrait être limité aux phases exploratoires (brainstorming d’idées, questionnement initial) où l’on peut se permettre de prendre la sortie de l’IA avec précaution. Quoi qu’il en soit, s’en tenir au prompt naïf ne permet pas d’exploiter pédagogiquement le LLM de façon fiable. C’est pourquoi il doit idéalement céder le pas à des approches plus structurées. - Niveau 2 : Prompt structuré de type « assistant réflexif basique »
À ce palier, on formule la requête de manière plus directive pour cadrer la réponse de l’IA. L’idée est de demander une réponse organisée et tempérée, éventuellement avec citations, sans toutefois fournir nous-même de documents sources. Par exemple, on peut utiliser un gabarit de question invitant l’IA à répondre en plusieurs paragraphes équilibrés, en mentionnant ses sources d’information ou du moins en nuançant ses affirmations (ce que nous appellerons format RCT ). L’agent conversationnel est ainsi incité à se comporter en assistant réflexif plutôt qu’en simple juke-box à réponses toutes faites. Un prompt de niveau 2 pourrait être : « Instruction : Rédige une réponse argumentée d’environ 4 paragraphes sur [la question X]. Assure-toi d’expliquer tes raisonnements et d’étayer chaque point par une source fiable. Adopte un ton objectif et modéré, en présentant éventuellement les limites ou incertitudes du sujet. Conclus par une brève synthèse. »
Avec une telle invite, le LLM va généralement structurer son propos (introduction, développement, conclusion) et tenter de citer des références (par exemple « selon un rapport de l’UNESCO de 2021… »). On obtient ainsi une réponse plus posée, plus prudente dans ses formulations, qui donne l’illusion d’un discours académique maîtrisé. Néanmoins, il faut rester vigilant : sans ancrage documentaire explicite, l’IA risque fort de fournir de fausses références pour satisfaire la demande[1]. Autrement dit, le modèle simule la démarche scientifique (citation, recul critique) mais puise toujours dans son seul entraînement pour le contenu factuel. Il n’est pas impossible d’obtenir une réponse globalement correcte à un sujet connu avec ce niveau 2, surtout si le LLM est de dernière génération. Cependant, sur des questions pointues, on n’est pas à l’abri d’une réponse bien écrite en apparence mais mêlant vérités et affabulations. Le niveau 2 n’est donc qu’une étape intermédiaire : il améliore la présentation et incite le modèle à l’auto-modération, sans pour autant garantir la factualité. On peut voir cela comme un moindre mal par rapport au niveau 1, utile pour apprendre aux élèves à structurer une réponse et à citer des sources – tout en ayant conscience que les références fournies devront être vérifiées.
Dans un registre ironique, on pourrait qualifier de « prompt du mois » certains usages naïfs de niveau 2 ayant fleuri sur le web. Par exemple :
Exemple de « prompt ultime du mois » (niveau 2) :
Utilisateur : « Donne-moi un exposé détaillé sur Napoléon Bonaparte, avec des références, en cinq paragraphes. »
Assistant : (génère un texte élégamment rédigé, contenant des citations historiques plus ou moins exactes, et mentionnant en référence une lettre apocryphe de Napoléon en 1803…)
Dans cet exemple fictif, le demandeur croit bien faire en imposant une structure et des citations, mais le LLM, dépourvu de sources réelles, a pu fabriquer des références pour obéir à l’instruction. La réponse paraît sophistiquée, pourtant elle reste un mirage du savoir – exactement le genre de sortie qu’un enseignant non averti pourrait prendre au sérieux à tort. Cela montre les limites du niveau 2 : sans données fiables en entrée, le vernis académique peut masquer un contenu erroné. D’où la nécessité de passer au niveau 3, où l’on fournit au modèle un contexte documenté et des instructions techniques précises pour verrouiller au maximum la qualité de la réponse.
- Niveau 3 : Prompt systémique avancé avec ancrage documentaire et réglages – Ce troisième palier mobilise pleinement les possibilités de prompt engineering pour transformer le LLM en assistant intelligent adossé à des connaissances contrôlées. Concrètement, le prompt de niveau 3 n’est plus une simple question, mais un scénario complet en plusieurs parties, typiquement construit en Markdown ou via l’API, incluant :
- Un contexte documentaire structuré: Par exemple un ensemble de textes ou données pertinents, fournis au modèle dans l’invite (découpés en chunks ou encodés en JSON). Ces documents servent de base de connaissance que le LLM sera tenu d’utiliser pour formuler sa réponse. On opère ici une forme d’ancrage sur des sources externes, proche du principe du Retrieval-Augmented Generation, afin de limiter les élucubrations. Le modèle puise alors dans un matériau fiable au lieu de se reposer sur sa seule « mémoire ».
- Des instructions de formatage et des paramètres de génération: On peut inclure, dans une section dédiée du prompt, des réglages sous forme de pseudo-code YAML (par ex. temperature: 0.2, top_k: 5, etc.) afin de réduire la part de créativité aléatoire du modèle[12]. Une température basse et un échantillonnage restreint encouragent des réponses plus déterministes et collées aux faits connus. On précise également le format attendu de la réponse : par exemple, exiger une réponse structurée avec un plan clair, des citations formelles (liées aux documents fournis) et même des balises Markdown spécifiques. Ces balises pourront être utilisées ensuite pour extraire ou afficher la réponse de manière formatée (par ex. encadrés de citation, liste de références, etc.).
- Une invite de raisonnement pas à pas (chain-of-thought) et de vérification: Le prompt system peut instructer le modèle à décomposer son raisonnement en étapes (c’est le principe de la chaîne de pensée, voir section suivante), éventuellement en lui donnant un ou deux exemples de démarche à imiter (few-shot exemplars). On peut aussi ajouter une étape de vérification où l’IA doit contrôler si sa réponse finalisée est cohérente avec les documents fournis (self-check). Par exemple, on pourrait inclure dans le prompt une directive du type : « Avant de donner ta réponse finale, parcours ton raisonnement et assure-toi que chaque affirmation clé est soutenue par une source du dossier ci-dessus. Si tu détectes une contradiction ou une donnée non sourcée, corrige-toi. ». Ce genre de méta-instruction pousse le modèle à s’auto-corriger en partie ses hallucinations résiduelles, en simulant une relecture critique.
En combinant ces éléments, le prompt de niveau 3 ressemble à un véritable scénario algorithmique. Par exemple, pour un devoir d’histoire, l’enseignant peut intégrer dans l’invite un extrait d’article de recherche (en précisant « Document A »), une chronologie événementielle (« Document B »), puis poser la question et demander une réponse structurée s’appuyant explicitement sur A et B. On parle alors d’IA “augmentée”, où le modèle ne travaille pas ex nihilo mais exploite du contenu validé. Divers outils et bibliothèques (tels LangChain, LlamaIndex, etc.) facilitent la construction de tels prompts multi-étapes, mais il est possible de le faire manuellement. L’important est que chaque étape vise à fiabiliser le résultat : l’IA ne fait plus qu’écrire en bon français, elle argumente avec des données précises, cite ses sources réelles, et réfléchit à haute voix (dans la partie non affichée à l’élève) pour éviter les incohérences.
Ce cadre progressif (du niveau 1 au niveau 3) permet d’éduquer à la fois le modèle et l’utilisateur. L’élève ou l’enseignant prend conscience qu’une bonne requête à une IA, ça se prépare et ça se structure, un peu comme une expérience scientifique. On peut même imaginer l’enseigner comme une nouvelle forme de littératie numérique. Bien sûr, mettre en place un prompt de niveau 3 demande du temps et des compétences techniques plus pointues, ce qui justifie pleinement une formation dédiée des enseignants (voir section 5). Mais les bénéfices pédagogiques sont clairs : on passe d’une utilisation superficielle, souvent trompeuse, à une interaction maîtrisée avec l’IA, où celle-ci devient un outil guidé, documenté et beaucoup plus fiable dans ses apports.
Avant de conclure sur les enjeux de formation, examinons plus en détail les techniques de pointe qui, à l’image du niveau 3, permettent de fiabiliser le raisonnement des LLM et d’envisager des usages éducatifs sécurisés.
4. Techniques avancées pour fiabiliser le raisonnement des LLM
Plusieurs méthodes issues des récents travaux en IA et en prompt engineering peuvent être combinées pour réduire les erreurs et hallucinations des modèles de langage. En voici les principales, qui commencent à être explorées pour rendre les LLM plus sûrs et performants :
- Chaîne de pensée (Chain-of-Thought, CoT) : Il s’agit de faire expliciter au modèle les étapes de son raisonnement, au lieu de le forcer à donner directement la réponse finale. En pratique, on inclut dans le prompt une consigne du type « Réfléchis étape par étape » (“Let’s think step by step”), ou on fournit des exemples de raisonnements découpés en plusieurs phrases logiques. Cette technique, apparue en 2022, a montré qu’un LLM peut ainsi approcher des tâches complexes de manière plus structurée, améliorant nettement ses performances de calcul, de déduction ou de résolution de problèmes[13][14]. La chaîne de pensée permet au modèle de simuler le processus cognitif humain en posant des sous-buts intermédiaires. Attention, toutefois : une CoT naïve n’élimine pas toutes les erreurs, car le modèle peut se tromper dès une étape et propager l’erreur[15]. Il manque en effet d’un mécanisme de relecture native. Mais combinée à d’autres astuces, la CoT est la pierre angulaire du raisonnement fiable en IA. Elle introduit une forme de transparence dans la génération : on peut suivre le fil des idées de l’IA et repérer où elle dévie.
- Arbre de pensée (Tree-of-Thought, ToT) : C’est une extension de la chaîne de pensée qui permet à l’IA non plus de suivre un unique fil, mais d’explorer plusieurs voies de raisonnement en parallèle[16][17]. Concrètement, le modèle génère différentes « pistes » de solution, évalue chacune (par exemple en vérifiant si elle semble mener à un résultat cohérent), puis approfondit les plus prometteuses. Cette démarche évoque un algorithme de recherche arborescente classique (par ex. un parcours en largeur ou en profondeur dans l’espace des solutions). Le Tree-of-Thought donne au modèle une sorte de capacité de « retour en arrière » et de regard global sur le problème, ce qui lui manque en génération linéaire standard[18][19]. Des travaux ont montré qu’avec ToT, un LLM comme GPT-4 résout bien mieux certains casse-têtes ou problèmes de planification qu’avec une simple CoT linéaire (passant de 4 % à 74 % de réussite dans un jeu mathématique donné)[20][21]. En éducation, on peut imaginer utiliser ToT pour des exercices ouverts où l’IA propose plusieurs hypothèses de solution et examine laquelle tient la route, ce qui constituerait un excellent entraînement à la démarche scientifique pour les élèves.
- Planification puis résolution (Plan-and-Solve) : Cette technique, introduite en 2023, vise à combler un défaut fréquent des CoT zéro-shot : les « oublis d’étapes » dans le raisonnement[22][23]. Le Plan-and-Solve prompting consiste à demander d’abord au modèle d’énoncer un plan général avant de se lancer dans la résolution détaillée[24]. Par exemple, pour un problème de maths complexe, l’IA annoncera en amont « Plan : 1) Calculer telle valeur, 2) Utiliser cette valeur pour… etc. », puis effectuera chaque étape. Ce découpage explicite aide à éviter que le modèle ne saute directement à une conclusion approximative. Des variantes dites PS+ ajoutent même une exigence de calcul minutieux à chaque étape, réduisant les erreurs arithmétiques[25]. En pratique, inciter l’IA à “planifier avant d’agir” la force à structurer sa démarche un peu comme on apprend aux élèves à rédiger un plan avant de rédiger un essai. On obtient des réponses plus complètes et cohérentes, avec moins d’étapes omises.
- Exemples en contexte (Few-Shot Prompting) : On a découvert avec GPT-3 que fournir au modèle quelques exemples de questions-réponses de la tâche à accomplir pouvait grandement améliorer ses performances[26]. C’est ce qu’on appelle l’apprentissage par contexte, par opposition au zéro-shot (aucun exemple fourni). Par exemple, avant de poser la question réelle, on peut montrer deux exemples d’analyse de texte réussie. Le LLM va alors ajuster sa production en se calant sur ces modèles. Pour les usages éducatifs, le few-shot est précieux : on peut montrer en entrée un exemple de réponse attendue de haute qualité, avec citations et mise en forme, ce qui sert de guide implicite à l’IA. Les recherches ont montré que plus le modèle est grand, plus il profite de ces exemples pour se corriger lui-même[27][28]. En somme, le few-shot prompting permet d’orienter le style et la précision des réponses sans modifier le modèle, simplement en enrichissant le prompt. Son revers est le coût en tokens (le contexte s’alourdit), mais pour des tâches cruciales on n’hésitera pas à l’utiliser.
- Méta-prompting : Sous ce nom on regroupe les approches où l’on utilise un LLM pour en optimiser un autre (ou lui-même). Autrement dit, on fait de la recherche de prompt automatisée grâce à l’IA. Par exemple, on pourrait demander à un modèle puissant de générer le meilleur prompt possible pour résoudre telle tâche avec un modèle plus simple. L’outil d’OpenAI appelé “Generate: Anything” illustre cette idée. Le méta-prompting, c’est « l’art d’écrire des prompts qui vont servir à en écrire d’autres ». Techniquement, cela peut passer par un prompt du genre : « Voici ma tâche… Propose cinq manières différentes de demander cela à un LLM, et indique laquelle tu estimes la plus efficace. ». Le grand modèle joue alors le rôle de conseiller en ingénierie de prompt, optimisant la formulation pour un but donné[29]. Une autre variante est l’approche Reflective, où l’IA génère des questions de clarification sur le problème avant même d’y répondre – une façon de créer un prompt plus précis. En somme, le méta-prompting cherche à tirer parti de l’intelligence du modèle pour affiner lui-même ses consignes. Cela s’inscrit dans une vision auto-réflexive des LLM, encore expérimentale mais prometteuse pour réduire les interventions humaines dans le prompt design.
- Auto-vérification (Self-Verification) : Inspirée par la manière dont un humain relit sa copie pour corriger d’éventuelles erreurs, la self-verification amène l’IA à vérifier son propre résultat en le confrontant à la question de départ. Une approche consiste à demander au modèle, après sa première réponse, de justifier chaque élément en le reliant aux conditions de la question. Par exemple, s’il a répondu à un problème de maths, on lui fait ré-évaluer la solution en vérifiant qu’en la prenant pour acquise on retombe bien sur les données initiales[30][31]. S’il détecte une incohérence, c’est que sa réponse est fausse. Techniquement, cela peut impliquer de générer plusieurs réponses candidates et de les tester l’une après l’autre, ou de faire tourner un second modèle en « juge » qui évalue la première réponse. Des travaux ont montré qu’en procédant ainsi, on améliore sensiblement l’exactitude sur des tâches de raisonnement[32][15]. Par exemple, un LLM entraîné à la self-verification a moins de chances de se tromper en logique ou en mathématiques, car il simule un contrôle de cohérence a posteriori. En classe, on pourrait imaginer un usage où l’IA fournit une réponse puis, sur demande de l’enseignant, explique pourquoi cette réponse est correcte en refaisant le chemin à l’envers – ce qui permettrait aux élèves de voir la vérification en action, et d’apprendre à douter d’une réponse tant qu’elle n’est pas justifiée.
- Chaînage de prompts (Prompt Chaining) : Plutôt que d’essayer de tout obtenir en une seule réponse monolithique, le prompt chaining préconise de décomposer une tâche complexe en plusieurs appels successifs au modèle[33]. Chaque sous-tâche est traitée par un prompt, souvent différent, et le résultat alimente le prompt suivant. Cette méthode, au cœur de nombreuses applications no-code avec LLM, améliore la fiabilité et la transparence en morcelant le problème[34]. Par exemple, pour un exercice de recherche documentaire, on pourra d’abord poser un prompt pour extraire les citations pertinentes d’un texte donné, puis un deuxième prompt pour résumer ces citations et répondre à la question finale[35][36]. En procédant ainsi, on contrôle mieux chaque étape (on peut vérifier les citations extraites avant de valider la réponse). Le chaînage de prompts est en quelque sorte l’implémentation pratique du niveau 3 mentionné plus haut : un enchaînement structuré de requêtes simples plutôt qu’une requête géante et opaque. Pour les enseignants, apprendre à penser en étapes avec les IA, un peu comme on découpe un problème en sous-problèmes algorithmiques, sera crucial pour concevoir des scénarios pédagogiques robustes avec ces outils.
- Appel à des outils externes (Tool-augmented prompting) : Une autre technique de fiabilisation consiste à doter le LLM d’outils qu’il peut appeler pour effectuer des sous-tâches spécialisées. Par exemple, une calculatrice pour les opérations arithmétiques, une base de connaissances pour les faits encyclopédiques, un moteur de recherche pour actualiser une information, etc. Le prompt est alors conçu de manière à indiquer au modèle quand et comment utiliser ces outils. Une célèbre méthode appelée ReAct (Reason + Act) fait alterner des phases de réflexion du modèle et des phases où il produit une action (comme une requête web)[37]. En éducation, cela pourrait signifier que l’IA, au lieu d’halluciner une date, irait la chercher dans Wikipedia via une API, ou qu’elle vérifierait un calcul en appelant un script Python. Augmenter le modèle par des outils externes réduit drastiquement le taux d’hallucinations, car dès que le LLM s’avoue incertain, il consulte une source fiable au lieu d’inventer[38][39]. Cette approche nécessite des systèmes hybrides un peu plus complexes à mettre en place, mais elle dessine l’avenir des assistants éducatifs : des IA intégrées à des écosystèmes documentaires et capables d’interagir avec des ressources vérifiées (manuels numériques, bases de données, etc.).
- Génération automatique de chaînes de raisonnement (Auto-CoT) : Enfin, mentionnons une avancée intéressante pour alléger la charge du prompt engineer humain. L’Auto-CoT (Automatic Chain-of-Thought) propose de générer automatiquement des démonstrations de raisonnement à partir du modèle lui-même[40][14]. Plutôt que d’écrire à la main des exemples de CoT pour chaque nouvelle tâche (ce qui est fastidieux), on peut entraîner le modèle à produire ces exemples de façon diversifiée. Une procédure décrite par les chercheurs consiste à faire regrouper les questions par type, puis à laisser le LLM créer un raisonnement détaillé sur une question typique de chaque groupe[41][42]. On obtient ainsi un ensemble d’exemples de chain-of-thought générés automatiquement, qu’on peut ensuite inclure en few-shot pour aider à résoudre les autres questions du groupe. Cette méthode a montré qu’on pouvait atteindre ou dépasser les performances de CoT écrites manuellement par des humains[43]. En d’autres termes, le LLM devient capable de fournir lui-même ses modes d’emploi internes, ce qui ouvre la voie à une amélioration autonome de ses capacités de raisonnement. Pour l’utilisateur final (enseignant ou élève), ces progrès se traduiront par des modèles progressivement plus fiables sans avoir à systématiquement peaufiner chaque prompt à la main. Néanmoins, à l’heure actuelle, profiter d’Auto-CoT exige encore de plonger dans des configurations techniques avancées, ce qui dépasse le cadre d’une classe ordinaire.
En synthèse, ce tour d’horizon des techniques (non exhaustif) montre qu’il existe une véritable boîte à outils pour rendre les IA génératives plus fiables. CoT, ToT, planification, self-checking, chainage, outils externes, etc., sont autant de pistes complémentaires qu’on peut associer dans un prompt système complexe. Certaines agissent en amont (structuration de la demande, limitation de la créativité), d’autres en aval (vérification et correction des réponses). Appliquées au domaine éducatif, elles convergent vers un même objectif : obtenir d’un LLM des réponses justes, explicables et utiles pédagogiquement, plutôt que des verbiages approximatifs. Cependant, atteindre cet objectif suppose que les acteurs de l’éducation, à commencer par les enseignants, s’approprient ces techniques. C’est tout l’enjeu du volet suivant.
5. Former les enseignants : au-delà de l’incantation à « l’esprit critique »
Si les méthodes ci-dessus paraissent techniques, elles n’en demeurent pas moins au cœur d’un usage éclairé des IA en éducation. Il est illusoire de penser que le seul « esprit critique » des usagers suffirait à conjurer les pièges des LLM. Bien sûr, face à n’importe quelle source d’information, il faut garder un regard critique : c’est une compétence que l’école a le devoir de développer. D’ailleurs, le Ministère de l’Éducation nationale rappelle dans son cadre d’usage de l’IA qu’il faut « examiner d’un œil critique les propositions […] vérifi[er] l’exactitude des réponses en comparant avec d’autres sources »[44]. Un élève entraîné à douter et recouper l’information sera moins vulnérable aux erreurs de l’IA; c’est indéniable. Cependant, en rester à ce discours général serait réducteur et insuffisant, pour deux raisons.
Premièrement, l’esprit critique ne s’improvise pas face à une machine aussi déroutante qu’un LLM. Pour qu’un enseignant ou un élève puisse réellement évaluer la fiabilité d’une réponse de ChatGPT, encore faut-il qu’il ait les moyens de détecter ce qui pourrait clocher. Or comment exercer son jugement critique sur un sujet qu’on ne maîtrise pas ? Bayart faisait remarquer que même un ingénieur cultivé peut se laisser abuser par un texte pseudo-scientifique bien tourné s’il n’est pas expert du domaine[9]. Un élève de collège aura bien du mal à repérer les subtilités fausses dans une réponse d’IA sur, disons, la guerre de 30 ans, s’il n’a pas déjà un bon bagage sur le sujet. Lui dire “use your critical thinking” sans autre forme d’accompagnement revient à lui demander l’impossible – il ne pourra critiquer que la forme, pas le fond, s’il n’a pas de référent. Par conséquent, l’enseignant doit intervenir en amont : en paramétrant l’outil pour limiter les égarements et en fournissant des sources fiables, il évite de placer l’élève en position de devoir trier le bon grain de l’ivraie tout seul. La formation des enseignants doit donc inclure cet aspect technique : savoir préparer un prompt structuré, connaître les limites du modèle et anticiper les erreurs possibles pour mieux guider les élèves ensuite.
Deuxièmement, réduire la formation à l’IA en éducation à la seule sensibilisation à l’esprit critique serait passer à côté du véritable enjeu. Celui-ci est double : (a) enseigner avec l’IA, et (b) enseigner sur l’IA. Enseigner avec l’IA signifie que les professeurs doivent apprendre à s’en servir intelligemment dans leur pratique quotidienne, ce qui inclut toutes les techniques vues plus haut (même si tout le monde n’ira pas manipuler du YAML, comprendre quelques recettes de prompt avancé sera précieux). Cela nécessite des formations pratiques, des ateliers où les enseignants testent différents niveaux de prompts, voient concrètement l’effet de l’ancrage documentaire, de la chaîne de pensée, etc. Sans cette appropriation, ils risquent de soit rejeter l’IA par peur de ses dérives, soit l’utiliser de manière inappropriée. Quant à enseigner sur l’IA, c’est rendre les élèves eux-mêmes conscients du fonctionnement probabiliste de ces modèles, de leurs biais, de pourquoi ils font des erreurs. Plutôt que de mystifier l’outil ou de simplement dire « méfiez-vous », il faut expliquer ses coulisses de manière pédagogique. Par exemple, faire réaliser en classe des petites expériences (demander à un LLM une absurdité et analyser la réponse, lui faire résoudre un problème avec et sans CoT, etc.) peut devenir un formidable exercice d’éducation aux médias et au numérique. Mais pour orchestrer cela, l’enseignant doit lui-même avoir un temps d’avance, d’où l’importance cruciale de sa montée en compétence.
Aujourd’hui, on observe encore un fossé entre le discours ambiant et la réalité du terrain. D’un côté, le buzz médiatique sur ChatGPT a pu donner l’impression qu’une nouvelle ère d’assistants éducatifs était à portée de clic ; de l’autre, les instances officielles appellent à la vigilance, en des termes parfois généraux. Ni l’angélisme technophile ni le scepticisme vague ne sont de bons conseillers. Ce qu’il faut, c’est un effort de formation et de documentation pour outiller concrètement les professeurs. Ils doivent savoir, très concrètement, comment rédiger un bon prompt, comment intégrer des sources, quels paramètres ajuster pour diminuer la créativité du modèle lors d’une tâche factuelle, quelles méthodes employer pour valider une réponse d’IA (par ex. utiliser un second modèle ou un moteur de recherche pour vérifier chaque point important). Sans cette maîtrise technique, l’enseignant ne pourra qu’exhorter ses élèves à faire preuve d’esprit critique – tout en étant lui-même à la merci des réponses fallacieuses de l’IA. Le risque, alors, est de se reposer sur la vigilance des élèves pour compenser l’absence de contrôle en amont, ce qui est une inversion des rôles problématique.
Former les enseignants aux LLM, ce n’est pas faire d’eux des programmeurs, mais des pédagogues augmentés d’une nouvelle compétence. De même qu’on n’imagine plus un professeur d’aujourd’hui sans aucune notion d’Internet et de recherche en ligne, on ne pourra bientôt plus concevoir un enseignant qui ignore tout du fonctionnement des IA conversationnelles. Il s’agit d’en faire des utilisateurs experts capables de tirer parti du niveau 3 (prompts avancés) pour concevoir des activités innovantes, tout en sachant redescendre au niveau 1 ou 2 de manière critique avec les élèves pour les éduquer au discernement. En dépassant le slogan « ayez l’esprit critique » pour entrer dans la maîtrise effective des conditions techniques, l’institution éducative armera réellement les enseignants et les apprenants pour l’ère de l’IA. Ce n’est qu’à ce prix que l’on pourra éviter aussi bien le rejet apeuré de ces outils que leur adoption irréfléchie.
Conclusion
Les LLM ne sont ni des ennemis à bannir, ni des oracles à idolâtrer. Ce sont des outils statistiques puissants, capables du meilleur comme du pire selon l’usage qu’on en fait. En éducation, un usage non maîtrisé (brut, sans filet ) revient à injecter un flux d’informations peu fiables en classe, ce qui serait irresponsable. Nous avons souligné les dangers de cette approche naïve, en montrant que les modèles propriétaires actuels hallucinent volontiers et que cela tient à leur nature même de générateurs probabilistes. Sans intervention de l’enseignant, un LLM n’a que faire de la vérité ou de la rigueur scientifique : il produira du texte plausible, voilà tout. C’est pourquoi nous préconisons un encadrement technique et méthodologique rigoureux de ces usages.
Un cadre progressif a été proposé, distinguant trois niveaux de prompts, du plus simple (question ouverte) au plus complexe (système structuré avec documents, réglages et vérifications). Cette gradation vise à montrer qu’il existe une marge de manœuvre importante entre l’ignorance totale et la maîtrise experte. Chaque enseignant peut, à son rythme, s’approprier certaines techniques de prompt engineering pour améliorer la fiabilité des réponses qu’il obtient de l’IA. De plus, nous avons passé en revue un ensemble de techniques avancées (CoT, ToT, planification, etc.) qui constituent la « trousse à outils » du pédagogue à l’ère de l’IA. Ces techniques, encore actives en recherche, convergent toutes vers l’idée qu’un LLM bien piloté peut raisonnablement fournir des réponses exactes, explicables, et adaptées aux besoins éducatifs, là où un LLM laissé en roue libre divague et désinforme.
Enfin, nous avons insisté sur la nécessité de former les enseignants pour franchir ce cap. Le défi n’est pas seulement d’aiguiser l’esprit critique des élèves face aux IA, mais aussi de donner aux professeurs les clés techniques pour paramétrer et utiliser ces IA de manière optimale. Cela implique de dépasser les peurs irrationnelles (du type « le robot va remplacer le prof ») tout autant que les engouements naïfs. L’ironie a voulu que certains observateurs, peu informés, aient pu vanter ChatGPT comme un tuteur universel infaillible. Nous espérons avoir montré qu’il n’en est rien sans un solide mode d’emploi pensé par l’humain. À l’inverse, d’autres ont cru éteindre le débat en invoquant l’esprit critique comme panacée. Nous avons argumenté qu’il fallait aller bien au-delà, sur le terrain concret de la littératie algorithmique.
En conclusion, intégrer les LLM en éducation de façon fructueuse supposera un équilibre entre prudence et innovation. Prudence, car il faut maintenir un haut niveau d’exigence sur la fiabilité des savoirs transmis aux élèves : les IA ne doivent pas introduire du faux sous couvert de modernité. Innovation, car ces modèles offrent aussi des opportunités inédites (différenciation pédagogique, entraînement personnalisé, aide à la rédaction, etc.) à condition de les déployer intelligemment. Les techniques de contrôle et d’amélioration du raisonnement de l’IA deviendront, à n’en pas douter, partie intégrante du bagage professionnel des enseignants du XXI^e siècle, tout comme la maîtrise d’Internet l’est devenue il y a une décennie. Plutôt que de subir le flot algorithmique, il s’agit d’en prendre les commandes, pour qu’au lieu d’un pipotron désincarné l’IA devienne un véritable outil au service de l’esprit critique et de l’apprentissage des élèves. C’est à cette condition que l’éducation saisira pleinement le potentiel des LLM, sans en subir les dérives.
Voici une illustration claire des trois niveaux de prompt sur le même cas pédagogique :
Créer un quiz d’histoire pour préparer le DNB sur les dates importantes.
Niveau 1 – Usage naïf (type “moteur de recherche”)
Prompt utilisateur :
Faire un quiz sur les dates à connaître en histoire pour le DNB.
Réponse typique de l’IA :
- Génération aléatoire de questions parfois hors programme, avec dates approximatives.
- Pas de structure ni de vérification, hallucinations possibles (« la Révolution industrielle a commencé en 1885 »…).
Analyse :
- Simple à utiliser.
- Risqué car aucune garantie de fiabilité.
- Bon pour un brainstorming initial, mais insuffisant pour un usage en classe.
Niveau 2 – Prompt structuré (Rôle, contexte, tâche – RCT)
Prompt utilisateur :
Tu es un assistant pédagogique rigoureux.
Génère un quiz de 10 questions pour préparer le DNB en Histoire,
centré sur les dates clés du programme officiel de Troisième.
Structure la réponse ainsi :
- Tableau avec trois colonnes : Numéro de question, Question, Réponse correcte
- Ajoute une brève explication de chaque réponse.
- Précise si tu n’es pas sûr d’une information.
Sortie attendue :
| # | Question | Réponse correcte |
|---|---|---|
| 1 | En quelle année a eu lieu la Révolution française ? | 1789 |
| 2 | Quand a eu lieu l’appel du 18 juin ? | 1940 |
Limites :
- Les questions seront souvent correctes mais pas toujours alignées sur le programme officiel.
- Pas de contrôle sur les sources.
- Peut inventer des explications ou confondre certaines dates.
- Utile pour structurer la production, mais pas encore fiabilisé.
Niveau 3 – Prompt système avancé avec base documentaire JSON (version volontairement « light », on peut faire beaucoup plus complexe)
Préparation :
- Base documentaire JSON exemple :
(par exemple :{ "1789": "Révolution française", "1914": "Début Première Guerre mondiale", ... })
Prompt système optimal en Markdown
## Rôle
Tu es un assistant d’Histoire pour le Diplôme National du Brevet.
Ta mission : créer des quiz fiables, basés **exclusivement** sur la base documentaire fournie.
## Paramètres YAML
temperature: 0.2
top_k: 5
format: tableau
max_questions: 10
## Base documentaire (JSON)
{
"1789": "Révolution française : début de la Révolution.",
"1914": "Début de la Première Guerre mondiale.",
"1939": "Début de la Seconde Guerre mondiale.",
"1940": "Appel du 18 juin par le Général de Gaulle.",
"1944": "Débarquement de Normandie.",
"1958": "Début de la Ve République.",
"1989": "Chute du mur de Berlin."
etc....
}
## Instructions
1. Génère un quiz de 10 questions en t’appuyant uniquement sur la base ci-dessus.
2. Structure les réponses dans un tableau avec colonnes : `#`, `Question`, `Bonne réponse`, `Explication`.
3. Vérifie à chaque étape que les dates et explications existent dans la base.
4. Attribue un point par bonne réponse et calcule le total à la fin.
5. Si une réponse est incorrecte ou partielle, propose une relance avec la correction.
6. Conclus par un résumé des erreurs fréquentes et des points à réviser.
Exemple de sortie attendue
| # | Question | Bonne réponse | Explication |
|---|---|---|---|
| 1 | En quelle année commence la Révolution française ? | 1789 | Début du processus révolutionnaire en France. |
| 2 | Quand débute la Première Guerre mondiale ? | 1914 | Déclenchement après l’assassinat de François-Ferdinand. |
Score final : 8/10
Relance : Relis les dates de 1940 et 1958, tu les as inversées.
Atouts du niveau 3
- Fiabilité : le modèle ne peut utiliser que les données fournies.
- Rigueur : température basse et top_k limité réduisent les hallucinations.
- Pédagogie : tableau clair, score calculé, relances ciblées.
- Évolutivité : facile d’ajouter d’autres dates dans le JSON pour enrichir le quiz.
Sources citées : Bayart B., « Intelligence artificielle, bullshit, pipotron ? », Libreàlire (2023)[3][4]; Balch D. E. & Blanck R., Mitigating Hallucinations in LLMs…, Faculty Focus (2024)[1][10]; OpenAI Cookbook, Enhance your prompts with meta prompting (2024)[29]; Bhatt B., Plan-and-Solve Prompting, LearnPrompting.org (2024)[22][23]; Bhatt B., Self-Verification Prompting, LearnPrompting.org (2024)[30][31]; Yao et al., Tree-of-Thought: arXiv (2023)[16][17]; PromptingGuide.ai, Few-Shot Prompting (2023)[26]; idem, Prompt Chaining[33]; Ministère Éduc. Nat., Cadre d’usage de l’IA en éducation (2025)[44].
[1] [2] [5] [10] [11] [38] [39] Mitigating Hallucinations in LLMs for Community College Classrooms: Strategies to Ensure Reliable and Trustworthy AI-Powered Learning Tools – Faculty Focus | Higher Ed Teaching & Learning
[3] [4] [6] [7] [8] [9] Intelligence artificielle, bullsh*t, pipotron ? Benjamin Bayart – Libre à lire !
https://www.librealire.org/intelligence-artificielle-bullsh-t-pipotron-benjamin-bayart
[12] [15] [30] [31] [32] Self-Verification Prompting: Enhancing LLM Accuracy in Reasoning Tasks
[13] [14] [40] [41] [42] [43] Automatic Chain of Thought (Auto-CoT)
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [24] [37] The Prompt Report Part 2: Plan and Solve, Tree of Thought, and Decomposition Prompting
[22] [23] [25] Plan-and-Solve Prompting: Improving Reasoning and Reducing Errors
[26] [27] [28] Few-Shot Prompting | Prompt Engineering Guide
https://www.promptingguide.ai/techniques/fewshot
[29] Enhance your prompts with meta prompting
https://cookbook.openai.com/examples/enhance_your_prompts_with_meta_prompting
[33] [34] [35] [36] Prompt Chaining | Prompt Engineering Guide
https://www.promptingguide.ai/techniques/prompt_chaining
[44] Cadre d’usage de l’IA en éducation | Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
https://www.education.gouv.fr/cadre-d-usage-de-l-ia-en-education-450647